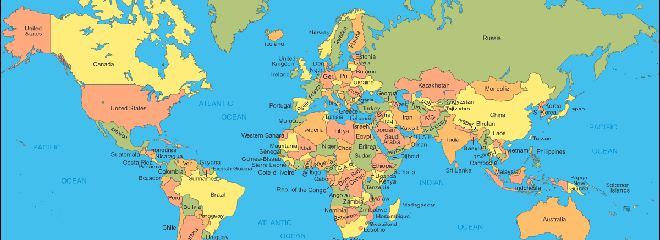Par Bernard Lord, Michael Churchill-Smith, Jean Belzile, Miguel Burnier, Luc Castonguay, Arvind Joshi, Cathy Séguin, Krishnakumar Udayakumar
En 2012, l'IASI-CUSM a amorcé son exploration des collaborations internationales avec une discussion en table ronde, présidée par M. Bernard Lord et le Dr Michael Churchill-Smith. L'événement a rassemblé des fournisseurs de soins de santé du Québec, de Toronto et des États-Unis, tous engagés dans des projets à l'étranger, et des hauts fonctionnaires québécois responsables du dossier des activités internationales dans le domaine de la santé
Comment la mondialisation transforme-t-elle le domaine des soins de santé ?
Arvind Joshi : Les soins de santé ont toujours été mondialisés. Par le passé, ils l’étaient de façon unidirectionnelle dans les trois axes qui sont les piliers d’un centre de santé universitaire, soit les soins, l’enseignement et la recherche. Patients et étudiants de pays en développement allaient dans les pays plus avancés pour se faire soigner et étudier. Mais l’ère de l’information a changé la donne et le monde entier a désormais accès aux données les plus récentes. Les pays considérés moins développés sont aujourd’hui des chefs de file dans plusieurs domaines de la santé, et les échanges ne sont pas bidirectionnels mais multidirectionnels. Cela crée des occasions de partenariat qui procureront un accès plus équitable aux soins, à l’échelle locale et mondiale. Les progrès des technologies de l’information, de l’imagerie 3D et de la chirurgie robotique feront disparaître les frontières des soins de santé, comme ce fut le cas dans d’autres secteurs. Selon moi, ces progrès offrent des occasions qu’il faut saisir.
Cathy Séguin : L’Hôpital pour enfants malades de Toronto (Hospital for Sick Children) est connu dans plus de 180 pays. Nous y avons établi un vaste programme postdoctoral international ainsi que de nombreuses collaborations scientifiques, qui n’ont pas cessé de s’étendre au cours des dernières décennies. Conformément à sa vision (Des enfants en santé, un monde meilleur), l’Hôpital a procédé à un examen stratégique de son rôle et de son influence potentielle auprès des enfants. Au terme de cet examen, nous avons élaboré une stratégie pour l’ensemble de l’institution, dont une orientation internationale importante centrée sur trois volets. Le premier s’intéresse au développement des affaires, plus précisément aux services-conseils dans lesquels s’inscrit le vaste projet que nous menons actuellement au Qatar. Le deuxième se rapporte à la santé des enfants à l’échelle mondiale, qui comprend des activités dans les pays en développement, entre autres l’établissement d’un programme de formation en soins infirmiers pédiatriques au Ghana, en Éthiopie et en Tanzanie, subventionné par l’ACDI. Le troisième volet a trait aux patients internationaux, un programme établi depuis longtemps qui s’adresse essentiellement aux enfants devant subir des chirurgies spécialisées. Ces derniers, qui représentent environ 1 % des activités de l’Hôpital, sont souvent issus de pays en développement et ont accès à nos soins grâce à des œuvres philanthropiques.
Nous savons d’expérience que nos partenaires ont à cœur de développer leurs propres compétences et des systèmes de santé durables. Nous travaillons avec eux pour les aider à réaliser leurs objectifs.
Miguel Burnier : Je dirige depuis 18 ans le laboratoire de pathologie oculaire du CUSM, qui effectue des biopsies de l’œil pour examiner les cancers et autres lésions. Notre laboratoire est aujourd’hui le plus important en Amérique du Nord ; nous avons une équipe internationale de 14 à 21 brillants jeunes gens qui y travaillent et étudient. Selon nous, le meilleur moyen de se préparer à la mondialisation, c’est par l’enseignement, la recherche et la prestation de soins à l’échelle internationale.
Au cours des 10 dernières années, le laboratoire a formé 140 étudiants provenant de 25 pays, qui sont retournés chez eux pour mettre sur pied de nouveaux labos. Sept pays – Espagne, Portugal, Mexique, Brésil, Argentine, Chili et Arabie saoudite – ont désormais le leur et collaborent avec nous grâce à la télémédecine. Nous entretenons les relations qui se sont établies dans les premières années de formation et mettons sur pied des partenariats avec des entreprises et des particuliers afin d’équiper les laboratoires et permettre aux gens que nous formons de servir leurs communautés et de poursuivre les collaborations. Les nouvelles technologies, dont la télémédecine et la pathologie numérique, facilitent grandement les consultations à distance. Notre société professionnelle (Biopsy) organise des conférences bisannuelles dans différents pays, ce qui contribue à consolider les relations.
Krishnakumar Udayakumar : À l’Université Duke (UD), nous considérons les activités internationales comme une occasion de formation bidirectionnelle – non seulement pour ajouter de la valeur, mais aussi pour apprendre de nos partenaires – et une plateforme d’innovation. Nous croyons que deux ou plusieurs têtes, venues d’ici et d’ailleurs, valent mieux qu’une seule pour développer, évaluer et mettre en œuvre des projets.
À l’internationale, les principales activités de l’UD se déroulent à Singapour où, en 2005, nous avons fait équipe avec les ministères de l’Éducation, de la Santé et du Commerce ainsi qu’avec l’Université nationale de Singapour (UNS) pour créer la première école de médecine offrant une formation de deuxième cycle en Asie du Sud-Est. Singapour a déjà un système de soins de santé très efficace, mais peu de médecins ont la formation voulue pour transférer les connaissances acquises par la recherche au domaine clinique. Il fallait des cliniciens capables de comprendre la science et de prendre en charge la recherche, et des scientifiques capables de comprendre les exigences cliniques.
L’UD a structuré son programme de médecine de manière à former des cliniciens qui ont des connaissances de base en recherche. Il y avait donc une synergie unique entre les besoins de l’UNS et l’expertise de l’UD. Les deux institutions ont mis sur pied leur partenariat il y a sept ans et depuis, deux promotions d’étudiants ont obtenu un diplôme de médecine dans le cadre du partenariat. Plus de 50 scientifiques du groupe UD-UNS s’emploient à faire de la recherche de pointe dans des domaines allant des troubles cardiovasculaires et métaboliques aux maladies infectieuses émergentes. L’expérience a fortement motivé l’UD à entreprendre des projets à valeur ajoutée qui s’inscrivent étroitement dans sa mission universitaire et comportent des activités de recherche et d’enseignement.
Luc Castonguay : Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec s’intéresse de près à la question de la mondialisation, car nous participons à de nombreuses collaborations avec des chercheurs du monde entier. L’expertise de nos scientifiques et de nos institutions est bien établie, et nos ministres, quand ils sont invités à l’étranger ou reçoivent des délégations internationales, se font poser beaucoup de questions quant à nos réalisations et à nos partenariats.
La mondialisation comprend aussi la commercialisation des résultats de la recherche et de l’expertise. Il s’agit là d’un domaine relativement nouveau qui doit être examiné avec soin dans le contexte d’un système de santé public dont le mandat est de servir la population du Québec. Il faut tenir compte des pressions financières qui s’exercent sur le système et les préoccupations soulevées par les listes d’attente quand nous envisageons des collaborations mondiales qui incorporent la commercialisation des services de santé.
Jean Belzile : Le monde change et on assiste à l’émergence de nouveaux modèles pour la communication de la recherche partout dans le monde. Cet environnement présente des défis pour des intervenants comme les pharmaceutiques, durement touchées dernièrement, mais reflète aussi une tendance généralisée, car des changements semblables s’opèrent depuis plusieurs années déjà dans des secteurs comme l’aérospatiale et les télécommunications.
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a encouragé l’établissement de partenariats entre l’industrie, les universités et les institutions publiques afin de partager les risques, les récompenses et les connaissances acquises par la recherche, et d’assurer notre compétitivité sur la scène mondiale. Les partenariats se forment sur la base d’une expertise unique dans un domaine particulier. Mais il est impossible d’exceller dans tous les domaines. Nos moyens, nos connaissances et notre main-d’œuvre comportent des limites. Nous devons établir les priorités et faire des choix quant à la manière d’investir nos ressources. Le Canada produit environ 5 % de la connaissance mondiale et le Québec, à peu près 1,5 %. Cela rend le réseautage et les partenariats internationaux d’autant plus importants pour l’avenir.
Quelles seront les possibilités qui découleront de cette évolution ?
Krishnakumar Udayakumar : En participant à la prestation des soins de santé à l’étranger, on a l’occasion de côtoyer des innovateurs et entrepreneurs du monde entier et d’apprendre auprès d’eux. Par exemple, comment la clinique de soins oculaires Arvind (sud de l’Inde) réussit-elle à pratiquer des chirurgies de la cataracte de qualité équivalente à la nôtre pour 20 $ ?. Comment l’Hôpital NH Heart arrive-t-il à faire des pontages coronaires pour moins de 2 000 $ ? Les coûts de main-d’œuvre sont moins élevés, certes, mais ça n’explique pas tout. C’est surtout l’innovation, les modèles d’affaires et la technologie qui façonnent leur modèle thérapeutique. On peut apprendre beaucoup auprès de ces organisations – pourvu qu’on y soit intégré – et importer le savoir acquis au pays pour améliorer nos soins, réduire les coûts et faciliter l’accès pour nos propres populations.
Miguel Burnier : La mobilité de médecins possédant différentes expertises comporte des avantages certains. La toxoplasmose est une maladie de l’œil causée par un parasite qu’on trouve dans l’eau potable. C’est à l’Université de São Paulo, au Brésil, qu’on trouve les meilleurs experts du monde, en partie parce que ces derniers traitent tous les jours une centaine de patients qui en sont atteints. En 2002, il y a eu une rare éclosion de la maladie à Vancouver, et des médecins brésiliens sont venus donner un coup de main, nous aidant à sauver des yeux et des vies.
Cathy Séguin : Du point de vue de la recherche, il est avantageux de collaborer avec d’autres pays. Cela élargit la portée et la profondeur des approches thérapeutiques, tout en enrichissant l’expertise canadienne.
Michael Churchill-Smith : La collaboration mondiale permet parfois de contourner des problèmes attribuables à des limites dans la formation. Par exemple, on a mis au point des techniques d’insertion de prothèses valvulaires qui peuvent se faire dans la salle d’angiographie au lieu du bloc opératoire. Pour bien maîtriser l’intervention, les cardiologues et les chirurgiens cardiaques doivent en faire beaucoup, mais la disponibilité des salles et le nombre de patients sont limités. Alors, pourquoi ne pas installer un environnement de formation dans un pays où le volume de patients est plus élevé et demander à des cardiologues de McGill ou de l’U de M de former nos propres chirurgiens et d’autres dans des conditions propices à leur apprentissage ?
Arvind Joshi : En partenariat avec Medanta Medicity, à Gurgaon (Inde), l’Université Duke est en train d’acquérir de l’expérience dans la greffe du foie. Le CUSM est reconnu pour son expertise en chirurgie hépatobiliaire, mais c’est à Medanta Medicity qu’on pratique le nombre le plus important de transplantations hépatiques avec donneur vivant, soit 370 par année.
Krishnakumar Udayakumar : La stratégie de l’UD en matière de patients internationaux a été principalement motivée par des préoccupations humanitaires, mais aussi par le désir de tirer parti de nos centres d’excellence. Dans certains domaines, nous voulons ou avons développé des programmes qui seront ou sont déjà parmi les meilleurs du monde, et cela ne peut se faire sans l’accès à des patients du monde entier et à une présence mondiale.
Jean Belzile : Le gouvernement du Québec travaille avec des chercheurs et subventionne des consortiums qui regroupent des entreprises privées et des membres de la communauté médicale en vue d’atteindre une masse critique, de mettre au point des prototypes, de réaliser des essais cliniques et d’acquérir de l’expertise.
Nous travaillons aussi avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour amener le système de santé à s’ouvrir aux nouvelles technologies et à être parmi les premiers utilisateurs, de manière à produire les données et à évaluer les résultats grâce auxquels les développeurs seront en mesure d’établir des liens entre l’expérience québécoise et des partenaires éventuels au Brésil, au Qatar et ailleurs. Il y a des défis à relever et des garde-fous à mettre en place. Dans l’avenir que nous envisageons, nous bâtissons des réseaux ici, au Québec, obtenons de solides données sur notre population, puis établissons des partenariats à l’étranger pour commercialiser les connaissances acquises.
Krishnakumar Udayakumar : Nous allons dépasser la communication unidirectionnelle de l’information et de l’expertise pour aller vers la création mondiale de modèles novateurs de recherche, d’enseignement et, très bientôt espérons-nous, de prestation des soins de santé. Dans le nouveau paradigme, nous travaillons avec les meilleurs partenaires et essayons de nouvelles choses. À Singapour, nous avons adopté le programme de l’UD, mais avons pu mettre à l’essai des innovations qui auraient été trop avant-gardistes pour le campus américain. Nous avons mis en ligne tous les cours magistraux du programme scientifique de base et adopté un modèle d’apprentissage coopératif, déjà utilisé dans d’autres disciplines, mais tout de même audacieux pour l’école de médecine. Nous avons maintenant accumulé cinq années de données montrant que ce modèle est aussi bon, sinon meilleur, que notre modèle américain, et cela nous a aidés à convaincre le comité des programmes aux États-Unis de l’adopter non seulement pour l’école de médecine, mais aussi pour tous les programmes de premier cycle. Nous avons réussi à créer un modèle à l’étranger, à tirer des leçons de l’expérience et à effectuer le transfert des connaissances en vue d’améliorer les soins, l’enseignement et la recherche.
Luc Castonguay : Le ministère de la Santé et des Services sociaux collabore maintenant avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour mieux comprendre les occasions offertes par la mondialisation. De toute évidence, on ne peut improviser ici. Il y a des occasions, mais aussi des défis et des risques que nous allons devoir apprendre à mesurer. Il nous faudra acquérir l’expertise voulue pour comprendre les marchés internationaux de la santé et les avantages des collaborations pour notre propre système de santé, que ce soit pour la recherche, la mise au point de services et d’expertise ou la commercialisation.
À quels défis politiques sommes-nous confrontés dans la poursuite de nouvelles possibilités à l’échelle mondiale ?
Arvind Joshi : Il faudra absolument modifier ou adapter des lois et règlements provinciaux et fédéraux si l’on veut s’affirmer comme joueur important sur la scène mondiale. Les nouveaux partenariats comportent des risques, c’est sûr, mais nous aurons plus à perdre si nous laissons passer le train et ne participons pas activement au mouvement de mondialisation des soins de santé.
Luc Castonguay : L’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) nous a approchés pour que nous examinions ensemble des moyens de valoriser les soins et les activités de nos centres hospitaliers universitaires, et un comité a été créé pour amorcer les travaux qui prennent en compte la mondialisation. Le but, c’est de trouver des moyens de minimiser les obstacles règlementaires et législatifs tout en préservant l’espace public et les caractéristiques qui définissent la prestation des soins dans le cadre d’un système public.
Bernard Lord : Que faudrait-il pour démontrer aux Québécois et aux Canadiens que l’ouverture de notre système de santé aux patients internationaux, avec toutes les précautions qui s‘imposent, pourrait apporter des ressources au système plutôt que de lui en retirer?
Arvind Joshi : En raison de contraintes financières et autres, nos salles d’opération et d’imagerie diagnostique sont exploitées à 30 % seulement, c’est-à-dire inoccupées 70 % du temps. Compte tenu de l’excellente qualité de nos soins et de leur prix concurrentiel, pourquoi ne pas s’en servir les samedis et les dimanches pour opérer des patients de la Nouvelle-Angleterre qui ont besoin d’une arthroplastie ? Cela coûterait moins cher pour les patients, créerait des emplois au Québec et renflouerait les coffres de l’État.
Cathy Séguin : À l’Hôpital pour enfants malades, nous avons toujours accordé la priorité à nos citoyens, et la question des patients internationaux est délicate. Ces derniers occupent une place importante dans nos activités, mais nous avons établi des limites. Cependant, nous pourrions générer des fonds en utilisant l’équipement et les blocs opératoires dans les périodes inoccupées pour améliorer les résultats financiers de l’hôpital et soutenir ainsi les soins aux patients. Cela veut dire que nous pouvons embaucher plus de personnel, exploiter la capacité et améliorer la productivité.
Accroître les activités pour des patients venus d’ailleurs serait en fait une très bonne chose, pourvu qu’elle soit bien planifiée et encadrée.
Miguel Burnier : Nous pourrions établir une distinction très nette entre les patients qui viennent ici pour des interventions complexes précises et d’autres pour des opérations de routine. Le public ne s’oppose pas aux premières, contrairement aux secondes.
Luc Castonguay : Nous vivons dans un monde où les apparences sont parfois plus dommageables que la réalité. Il faut bien documenter ce que nous voulons faire et procéder avec précaution. Il sera plus facile de voir comment les choses se déroulent avec les patients étrangers en tentant des expériences sur petite échelle. Nous aurions ainsi la possibilité de nous accoutumer à une certaine façon de faire avant de changer nos règlements et nos lois.
Il faudra peut-être partager les responsabilités et l’expertise de manière à soutenir et à protéger les deux mondes : celui qui fournit les services de santé et celui qui les commercialise. Nos infirmières et médecins sont là pour soigner notre population, et la commercialisation des soins à l’étranger ne s’inscrit peut-être pas dans leur fonction.
Mais il est un piège qu’il faut absolument éviter, c’est-à-dire considérer le commerce des services ou de l’expertise en santé comme une source de financement du régime. Nous entendons souvent parler de l’énorme potentiel du marché mondial des services de santé, des milliards de dollars dit-on, mais les risques sont grands et les garanties inexistantes. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de la commercialisation de la recherche universitaire à des fins de financement. Cela ne s’est pas produit au Québec, ni au Canada ni ailleurs. S’il y a des retombées financières, ce sera toujours en marge du financement des services.
Arvind Joshi : Au Québec, la situation des professionnels de la santé qui travaillent en dehors du régime public met en évidence le potentiel de retombées financières. Le dentiste qui pratique à Montréal reçoit toutes sortes de patients du nord-est américain. Les chirurgiens montréalais font de la publicité aux États-Unis parce que leurs prix sont concurrentiels et leurs soins de qualité supérieure, et on peut en dire autant pour les techniques de procréation artificielle. La clientèle étrangère ne cesse de grandir. Il y a des gens qui paient pour se faire soigner dans mon hôpital. Mais quand j’inscris ces revenus dans mes états financiers, on me les soustrait du total.
Je crois que nous devons reconnaître l’existence du problème et nous y attaquer. Les publicités indiennes sont très accrocheuses : « Venez subir une arthroplastie chez nous et récupérer dans un spa ayurvédique ». On en fait pratiquement une politique nationale. Je considère notre inaction comme une occasion ratée.
Michael Churchill-Smith: D’autres pays s’engagent dans cette voie. L’été dernier, pendant les Jeux olympiques, il était intéressant de voir à la télévision des publicités du NHS (le service de santé national britannique). Le ministère de la Santé a consacré une partie de son budget à promouvoir la réputation du NHS. Cela en dit long sur le changement de mentalité du gouvernement britannique.
Luc Castonguay : C’est là un dossier que l’on doit examiner très attentivement avant d’aller de l’avant. Les établissements de soins de santé veulent que nous agissions à cet égard. Le comité que nous avons mis en place avec l’AQESSS se penche sur la question. Nous devons en savoir davantage sur les enjeux en cause, après quoi nous serons en mesure d’établir des garde-fous et d’agir avec transparence.
Cathy Séguin : En ce moment, il se dépense beaucoup d’argent pour les soins à l’étranger, mais je crois qu’il y aura moins de patients qui se déplaceront pour obtenir des soins, en partie parce que nos partenaires veulent développer leurs propres compétences. Les collaborations internationales en matière d’enseignement et de recherche préparent les futurs dirigeants d’institutions étrangères. Il faut se concentrer sur le potentiel des collaborations à long terme, et non sur les possibilités à court terme.
Nos partenaires étrangers veulent notre aide pour se donner les moyens d’établir un système de santé durable.
Krishnakumar Udayakumar : L’intérêt que d’autres pays portent au Québec et au Canada ne se limite pas aux soins de santé. Les politiques, le financement, la prestation des soins et la structure des systèmes ont une valeur pour les pays qui sont en train de mettre sur pied leur système. C’est une expertise qui peut être commercialisée dans le cadre d’un partenariat public-privé.
Michael Churchill-Smith : Le Québec et le Canada sont déjà engagés dans des projets à l’étranger. Maintenant, il s’agit de déterminer comment accélérer le développement, compte tenu des risques, et pénétrer plus avant sur les marchés qui émergent et requièrent notre expertise.